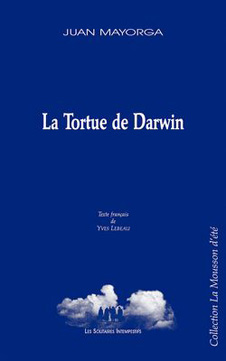Un théâtre où l’on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire, Bertolt Brecht
 Avec ses cortèges de corps décomposés, ses danses et ses travestissements joyeusement morbides, la peste noire, maladie de l’apocalypse par excellence, provoque le désordre dans l’horlogerie sociale, libère les puissances instinctives et sauvages et fait resurgir le fond obscur de l’Homme. Pouvant se transmettre à celui qui vit à l’écart des malades et laisser indemne celui qui les veille, ignorant le criminel et anéantissant en une nuit un millier de justes, la grande farandole macabre rappelle aux hommes la fragilité de leurs raisons d’être, les ténèbres dont ils sont issus et l’aléatoire de toutes leurs catégories morales. Dans le fantasme du surgissement épidémique se fait toujours clairement entendre ce désir archaïque de destruction totale des édifices sociaux et de leurs mirages.
Avec ses cortèges de corps décomposés, ses danses et ses travestissements joyeusement morbides, la peste noire, maladie de l’apocalypse par excellence, provoque le désordre dans l’horlogerie sociale, libère les puissances instinctives et sauvages et fait resurgir le fond obscur de l’Homme. Pouvant se transmettre à celui qui vit à l’écart des malades et laisser indemne celui qui les veille, ignorant le criminel et anéantissant en une nuit un millier de justes, la grande farandole macabre rappelle aux hommes la fragilité de leurs raisons d’être, les ténèbres dont ils sont issus et l’aléatoire de toutes leurs catégories morales. Dans le fantasme du surgissement épidémique se fait toujours clairement entendre ce désir archaïque de destruction totale des édifices sociaux et de leurs mirages.
La peste (celle du moins qui reste à l’état de prévision) est ainsi un rêve politique. Car si la maladie concerne l’individu, l’épidémie interpelle la communauté et questionne essentiellement le lien entre les êtres. Quand les hommes ne savent plus très bien ce qui les fait tenir ensemble, quand le sentiment d’impuissance à agir sur le monde devient quasi-général, le rêve de peste peut être lu comme le désir d’une immense liquidation, celui d’une vengeance contre l’immuabilité de l’ordre social et la lenteur complexe des affaires humaines. Fêtes purificatrices, lois suspendues, interdits levés, frénésie du temps qui passe, corps se mêlant sans respect, le rêve de peste peut être à l’inverse synonyme d’une surveillance généralisée, d’un quadrillage minutieux des villes, d’une séparation stricte entre les êtres. Que la peste soit une des métaphores célèbres du fascisme en dit assez sur le côté trouble et ambivalent de ce désir.
Et puis il y a celui qui saute à la corde dans les décombres. Qui chante les deux pieds dans la merde. Terriblement fier de vivre, il ne dit rien d’autre que sa profonde inadaptation à tout, voire la profonde inadaptation de tout à lui. Il ne se justifie pas, il est. Au milieu des lamentations, des débauches et des sauve-qui-peut hystériques, sa joie toute pure fait scandale. Ignorant ou refusant de considérer la soi-disante gravité des situations et les conséquences qu’elles impliquent, il acquiert par son refus actif du désespoir et de l’affliction un potentiel de résistance à la violence qu’il traverse. Idiot ? Clown ? Innocent ? Révolutionnaire ? Poète ? Le rire qu’il suscite, la force majeure qu’il revendique et exprime, deviennent non seulement des bouées de sauvetage mais des moyens de révélation. Il dénoue des conflits, dégage des forces et déclenche des possibilités.
Quelles seraient aujourd’hui les écritures qui viendraient appréhender ce motif de la catastrophe, de la grande épidémie rédemptrice, non plus pour se lamenter sur l’inanité actuelle, mais pour questionner peut-être, cette sensibilité catastrophiste, ce désir ambivalent d’apocalypse qui traverse la sensibilité contemporaine ? Des écritures qui viendraient révéler ce qui au cœur du désastre insiste, s’obstine à être et exige surtout d’être pensé ? Echappées belles et vivaces, contradictions motrices, pouvoir d’énonciations retrouvés ?
Samuel Gallet
Le Festival
Les lectures au café
Lundi 14 décembre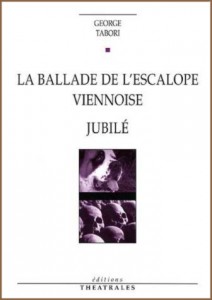
La Ballade de l’escalope viennoise
de Georges Tabori
traduit de l’allemand par Maurice et Renate Tazman
Éditions Théâtrales, 2001
Le rire est la seule chose qui reste après la catastrophe.
George Tabori
Avec Léo Ferber, Grégory Faive, Bernard Garnier, Dominique Laidet, Sophie Vaude…
L’escalope viennoise n’est plus ce qu’elle était, elle s’est ratatinée tout comme l’empire austro-hongrois et Vienne n’est plus dans Vienne : Morgenstern voit des SS où il n’y en a pas, des émules de Freud le soignent dans une clinique vétérinaire parmi des gorilles et des ours polaires. Il ne lui reste plus qu’à invectiver Dieu, tout comme Job.
Auteur de théâtre, scénariste, romancier, nouvelliste, metteur en scène, acteur, George Tabori est né à Budapest en 1914 dans une famille d’intellectuels juifs. Il séjourne en Allemagne en 1932 et 1933, puis émigre à Londres en 1935. En 1945, il s’installe aux Etats-Unis, y rencontre Brecht, écrit ses premiers romans ainsi que des scénarios de films pour Hitchcock, Losey et Litvak. Il est décédé en juillet 2007. Ses pièces sont éditées chez Théâtrales et Actes-Sud.
Lundi 18 janvier
The Great disaster
de Patrick Kermann
Lansman Éditeur, 1999
café restaurant la Frise
150 cours Berriat à Grenoble
Avec Stéphane Czopek et Bernard Garnier
Vingt ans dans les montagnes, quinze ans à apprendre le français et l’allemand en cherchant travail et fortune, cinq jours à faire la vaisselle sur le Titanic, et l’éternité pour hanter les flancs du navire et raconter sans cesse la même histoire, son histoire… ainsi peut se résumer la vie de Giovanni Pastore qui n’aurait jamais dû quitter sa Mamma.
Passager clandestin à bord du monstrueux paquebot, chargé de nettoyer quotidiennement les trois mille cent soixante dix-sept cuillères à dessert destinées aux passagers de première classe, il ressasse son existence avec humour et tendresse, donnant vie à ses propres fantômes. (NdE)
moi Giovanni Pastore n’ai pas écouté la Mamma
faut respecter ses parents avait dit le curé
et les grands-parents j’avais demandé
et paf deux paires de claques
et les ricanement des copains
Patrick Kermann est né en 1959 à Strasbourg. Il écrit pour le théâtre et pour l’opéra dès le début des années 90. Il est l’auteur d’une dizaine de pièces. “Sur scène, dans une balance incessante entre incarnation et désincarnation, matériel et immatériel, visible et invisible, apparaissent des fantômes qui portent la parole des morts, pour nous encore et tout juste vivants“. Patrick Kermann est décédé en 2000.